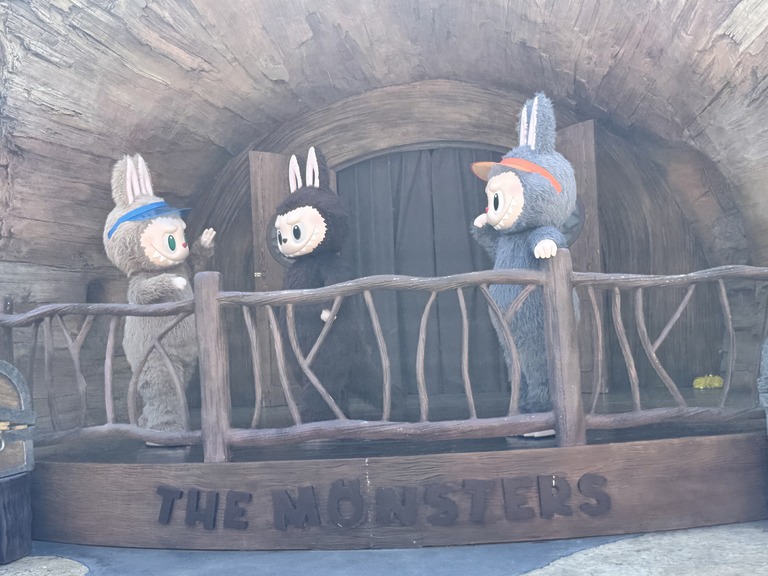Par Sébastien Appiotti, Maître de conférences au CELSA – Sorbonne Université et chercheur au GRIPIC.

©Sébastien Appiotti
Depuis sa création en 1956, le Concours Eurovision de la Chanson a révélé des stars mondiales telles qu’Abba et Céline Dion : le concours s’impose comme un espace public médiatique européen multiculturel et multilingue sans équivalent dans le monde en dehors des Jeux Olympiques. Ses 200 millions de téléspectateurs, ses 7 milliards de vues sur les réseaux sociaux numériques en 2024 font de l’Eurovision un moment rituel de célébration, aux forts enjeux communicationnels, politiques et sociaux. Qu’on y adhère ou non, l’Eurovision, d’une notoriété mondiale de 96%[1], est donc un phénomène culturel unique en Europe. Le concours cristallise par ailleurs des rivalités géopolitiques, depuis les tensions Est-Ouest pendant la Guerre froide jusqu’aux conflits récents (Ukraine/Russie ; Israël/Palestine ; Arménie/Azerbaïdjan). C’est un espace où l’Europe et ses voisins mettent en scène des identités nationales et des imaginaires partagés.
Pourquoi s’intéresser à l’Eurovision en tant qu’objet de recherche ?
Je comprends que ce choix puisse surprendre, car l’Eurovision a, notamment en France, la réputation d’être le temple de la ringardise, du kitsch et des chansons de mauvais goût ! Néanmoins, nous sommes plusieurs chercheurs au CELSA (Lisa Bolz, Juliette Charbonneaux, Hécate Vergopoulos, Thibault Grison, Léa Andolfi) et dans d’autres universités françaises et internationales à considérer que l’Eurovision est bien plus qu’un concours de chanson : cette émission de divertissement la plus regardée au monde chaque année nous permet d’interroger la mise en scène d’identités culturelles, l’importance des rituels collectifs dans nos sociétés, la participation sur les réseaux sociaux numériques, tout en éclairant les dynamiques politiques et sociales complexes de notre temps. Depuis plusieurs années, nombre de chercheurs, à partir de prismes disciplinaires et d’approches variées, développent ainsi des recherches sur le concours Eurovision de la chanson. Si des travaux précurseurs émergent dans les années 1980 en Suède[2], j’observe avec mes collègues une densification et une diversification des manières d’appréhender scientifiquement le concours : des recherches ont ainsi été menées de façon récente par le prisme de la géopolitique, des identités nationales et culturelles de l’Eurovision[3], de la musicologie et des pop cultures, de la sociologie de la culture et des études de fans, de l’histoire[4] ou encore des études de genre.
👇Ci-après le podcast de 12 Points – le podcast qui décrypte l’Eurovision pour en découvrir plus sur l’Eurovision comme objet de recherche 👇
En quoi portent plus précisément vos recherches sur l’Eurovision ?
Mes recherches partent d’un constat simple : la dimension médiatique et communicationnelle de l’Eurovision est indispensable à sa compréhension, et reste paradoxalement peu étudiée en France et à l’international. Ce point de départ m’a permis de déployer plusieurs enquêtes de terrain autour de l’Eurovision.
L’Eurovision étant un objet de recherche relativement nouveau en sciences de l’information et de la communication, la dimension collective de la recherche pour mutualiser nos envies, nos expertises et nos interprétations respectives. Nous l’avons fait de deux façons : premièrement, en organisant en 2024-2025 “Penser l’Eurovision”, premier séminaire de recherche en France dédié au concours. Deuxièmement, avec trois collègues enseignants-chercheurs (Lisa Bolz, Johan Boittiaux, Marie-Caroline Neuvillers), nous nous sommes intéressés à la manière dont les médias français (presse écrite nationale et régionale ; radio ; télévision) parlent de l’Eurovision depuis la fin des années 1990. Nos analyses nous ont notamment permis de saisir les fonctions assignées à l’Eurovision dans le discours médiatique (ex : le concours comme caisse de résonance pour des enjeux de société), mais aussi les principales thématiques abordées dans les archives analysées (mise en scène d’enjeux géopolitiques, mise en lumière de dynamiques socio-culturelles, storytelling de la participation de la France au concours, etc.).
De façon individuelle, je mène également une enquête de terrain depuis l’année dernière sur les cultures visuelles des publics et fans de l’Eurovision sur les réseaux sociaux numériques, et plus spécifiquement Instagram. En collaboration avec CERES, unité de service de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, j’ai collecté plus de 60000 images et vidéos postées à propos de l’édition 2024 du concours sur Instagram. Je compte entreprendre une démarche similaire cette année, afin de comprendre la manière dont est mis en scène l’Eurovision en ligne : quelles thématiques sont mises en avant, et pour quelles raisons ? Qu’est-ce qui est montré du concours, et au contraire, quels sont les sujets qui sont non-dits ou invisibilisés en ligne ? A contrario, est-ce que certains sujets, tels que la célébration de la diversité ou les rivalités géopolitiques, génèrent des désaccords interprétatifs, voire des controverses ?
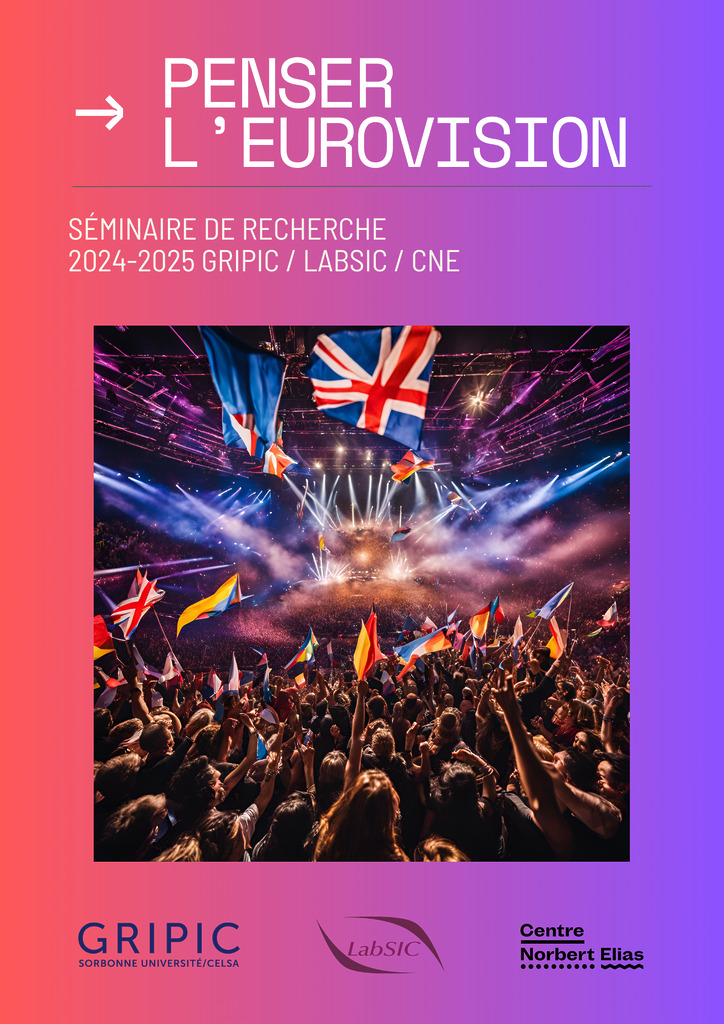
©Séminaire “Penser l’Eurovision par la communication”, laboratoires GRIPIC, LabSIC et Centre Norbert Elias, 2024-2025
Vous êtes actuellement à Bâle, ville hôte de l’édition 2025 de l’Eurovision : quelles sont vos premières observations et analyses à ce sujet ?
L’édition 2024 du concours s’est tenue à Malmö en Suède dans un contexte très particulier : le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a en effet cristallisé les débats et les contestations, du fait de la participation d’Israël au concours. Dans ce contexte, nos observations de terrain menées avec Lisa Bolz se sont principalement concentrées sur la compréhension des dynamiques de politisation d’un concours censé être neutre et apolitique, du moins en théorie. Sur site, nous nous sommes notamment intéressés aux traces et manifestations concrètes de résistance, voire de défiance face à l’Eurovision, dans un contexte où certains fans ont par exemple choisi de boycotter l’édition 2024 du concours.
Alors que le contexte géopolitique et social est tout aussi instable en 2025 (réélection de Donald Trump aux Etats-Unis, conflits entre la Russie et l’Ukraine, ou entre l’Inde et le Pakistan, remise en question des droits des femmes et de la communauté LGBTQIA+, etc.), mes premières observations à Bâle montrent que le concours est plutôt considéré par les fans et touristes comme une bulle d’insouciance, de joie et de références culturelles en commun face à un quotidien anxiogène. L’instant d’une semaine, une ville telle que Bâle se transforme en utopie des futurs possibles, à la fois pour les candidats participants et les publics présents sur place : cette utopie se caractérise à la fois par son interculturalité (l’Eurovision comme vecteur de compréhension réciproque entre cultures et nationalités), sa diversité (l’Eurovision comme espace sécurisant et d’acceptation sociale pour exprimer ses différences) et par l’importance de ses dynamiques de sociabilité (le concours comme catalyseur de rencontres et d’interprétations sur une grande diversité de thématiques).



© Sébastien Appiotti
[1] Eurovision Song Contest Brand Brand Impact Report, EBU, 2024. https://www.ebu.ch/research/loginonly/report/eurovision-song-contest-brand-impact-report
[2] Björnberg Alf (1987), En liten sång som alla andra : Melodifestivalen 1959-1983 [Une petite chanson comme toutes les autres : Melodifestivalen 1959-1983], thèse de doctorat, Université de Göteborg.
[3] Fricker Karen et Gluhovic Milija (dir.) (2013), Performing the « New » Europe. Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest, New York, Palgrave Macmillan.
[4] Vuletic Dean (2018), Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, New York, Bloomsbury.