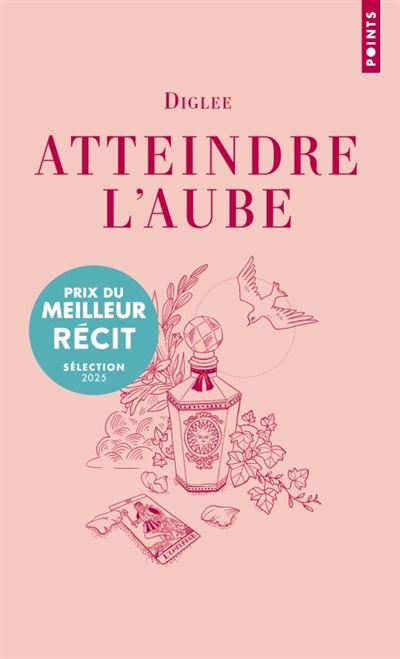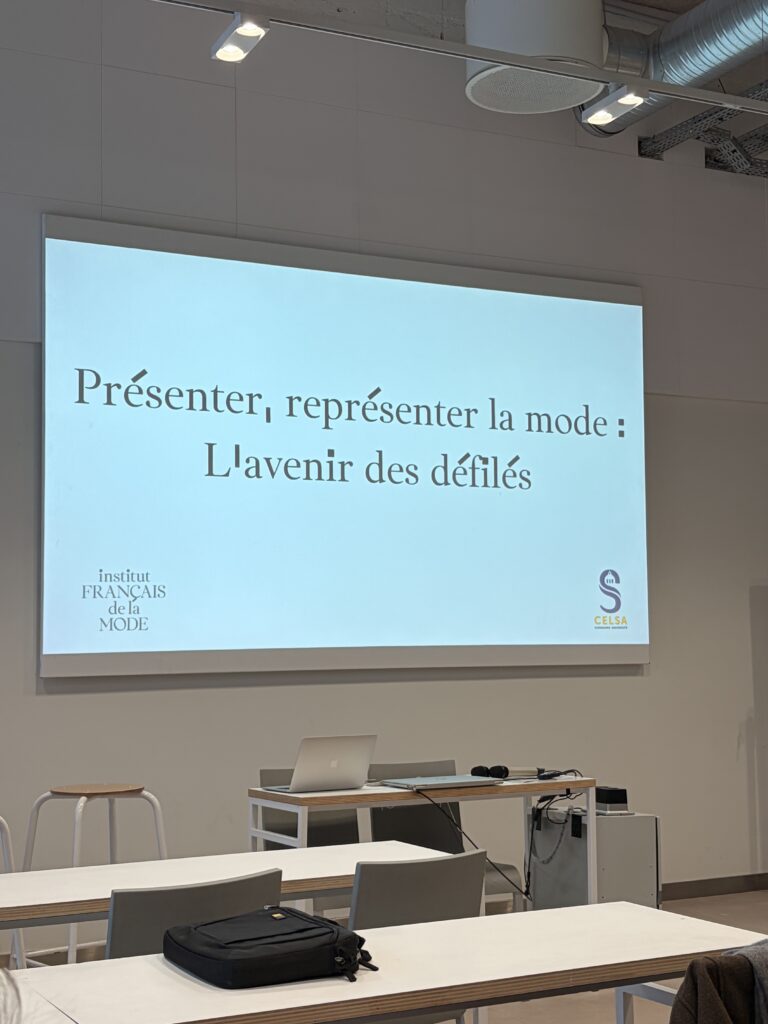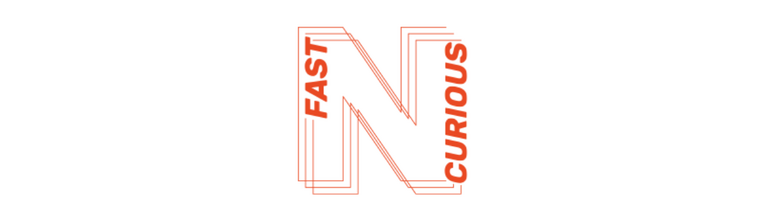Dans le prestigieux amphithéâtre Liard de La Sorbonne Université s’est déroulé la 4ème édition du Prix du Meilleur récit. Les étudiants du CELSA ont à cette occasion élu « Atteindre l’aube » de Diglee.
Olivier Aïm, enseignant chercheur au CELSA et responsable de ce partenariat déclare : « Le CELSA a toujours nourri un intérêt profond par la question des récits, de leurs résonances avec l’actualité et des nouvelles formes d’écriture. C’est pourquoi la participation à ce jury est une occasion pédagogique unique pour nos étudiants et nos étudiantes de découvrir de plus près les métiers de l’édition, tout en exerçant leur sens de la lecture, de l’argumentation et de l’échange autour d’œuvres mêlant une dimension à la fois artistique et documentaire sur les grandes questions de nos sociétés contemporaines. »
Cécile Boyer-Runge, Directrice générale des Editions Points souligne à son tour : « Les lecteurs du CELSA ont participé avec enthousiasme à cette 4eme édition. Cet engouement est pour nous un moteur puissant. La rencontre des étudiants avec Diglee restera un moment fort. ».
L’autrice Diglee a chaleureusement remercié le public ainsi que l’ensemble des étudiants. Émue, elle a pris la parole et adressé à l’assemblée un discours d’une grande intensité. Le voici dans son intégralité :

Depuis ma lecture des mémoires d’une jeune fille rangée de Beauvoir, j’ai toujours fantasmé la Sorbonne. J’imaginais d’obscurs couloirs alambiqués, des dortoirs, une cour ombragée, des salles de classe en sépia et des élèves en cravate, tous avides de littérature. C’était mon petit fantasme de lectrice provinciale.
Lorsqu’au lycée, il m’a fallu choisir une destinée sous forme d’école, j’y ai rêvé très fort. J’ai pensé à la jeune Simone, qui dans ses mémoires, écrit s’être sentie ici « enfin en contact avec le monde des esprits ».
La seule à avoir perçu mon fantasme, c’était ma prof de français. Madame Maynard. C’est elle qui m’a encouragée à candidater pour une prépa littéraire. La première à m’avoir dit tu es capable. La première à avoir compris que la littérature est mon pays. C’est aussi à ça, que peuvent servir les études. À nous autoriser.
On me demandait : que veux-tu faire plus tard ?
Mais à cette question, qui ose répondre écrivaine ?
Moi je n’ai pas su.
Les livres étaient trop nobles.
Finalement j’ai pris un autre chemin, moins académique, plus saltimbanque. J’ai intégré une école d’art, j’ai peint, étudié le nu, la sculpture et la perspective, dans la lignée de mes grands-parents rencontrés aux Beaux-arts.
Et en abandonnant mon rêve d’études littéraires, je me souviens avoir pensé, terrifiée : « Mais alors… on ne m’apprendra plus à lire. »
Les rêves de Sorbonne se sont éloignés mais jamais la lecture, ses gestes saugrenus, les pages des autres cornées, soulignées, les obsessions biographiques, les enquêtes syntaxiques, le plaisir des archives, des vieux papiers, des correspondances, des journaux.
J’ai découvert Anaïs Nin, Annie Ernaux, Lou Andréas Salomé, Colette, Claudie Hunzinger, Violette Leduc. J’ai pioché au hasard des rayons, et appris à lire sans guide. C’est plus long. Sur ma route d’autodidacte assoiffée, j’ai découvert les fantômes de Mireille Havet, Joyce Mansour et Rachilde, mais des vivantes aussi, Frédérique Germanaud, Eva Balthazar, Deborah Levy.
Je sais que personne n’aime les listes de noms à rallonge, mais je n’ai pas résisté au plaisir de les entendre résonner entre ces murs si symboliques.
Le monde de la littérature ne m’a finalement jamais paru si intime et si familier que depuis son bord. Je lis, et j’écris depuis l’autre rive, en catimini, depuis toujours. La honte doucement s’éloigne d’être une impostrice, une sans diplôme.
Je pensais avoir choisi une voie opposée à celle de la littérature, or depuis 2009, je fais des livres, je ne fais que ça. Je dessine et je raconte. C’est la même chose, mais je ne le savais pas.
Colette nous dit dans L’étoile vesper que « l’écriture est un dessin », et pour moi c’est vrai, écriture et dessin sont issus d’un même geste. Une question de regard en biais, de décentrage.
Reste l’illégitimité.
Recevoir dans cette école mon premier prix littéraire conjure un peu le sort. Et pour cela, infiniment, merci.
Certaines personnes écrivent. C’est ainsi, et c’est un immense mystère. C’est notre goût commun pour cette étrangeté qui nous rassemble ce soir.
Pourquoi continuer de croire en les livres ? Que peuvent-ils face à l’obscurantisme, au complotisme, que peuvent-ils face aux génocides, que peuvent-ils face à l’appauvrissement de la joie ?
Probablement rien.
Peut-être tout.
Et au fond ça ne compte pas, puisque les gens qui écrivent écrivent, et écriront toujours.
« On peut parler d’une maladie de l’écrit », nous dit Duras.
Les gens qui écrivent écrivent, dans cet inévitable labeur insécure, et c’est un mystère remarquable.
Pour terminer ce discours, j’aimerais vous lire quelques mots de Violette Leduc, tirés de son roman l’Affamée.
Ils me rappellent pourquoi, malgré la lutte, la honte, la peur et l’illégitimité, écrire reste une absolution.
« Assise à ma table, j’essaie d’écrire. Pendant que j’essaie, je me délivre laborieusement et innocemment de mon incapacité d’écrire bien. Ma plume grince. Je gémis avec elle. Nous gémissons pour rien. Nous formons ensemble des mots inutiles. J’ai honte d’infliger ce travail à ce petit objet capable. Pendant que je m’efforce, je trace la voie à mes impossibilités et je les oublie. Ce paragraphe les représente. Je ressemble à une personne qui se croit puissante quand elle lance de la poussière en l’air. Cette poussière retombe sur sa chevelure. Mes impossibilités retombent sur cette page. Plus je m’efforce, plus je crois que je travaille bien, plus je m’égare, plus je me drogue avec mon effort. Capables et incapables d’écrire, nous suons de la même sueur. L’effort est un faux frère. »
Merci